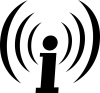Pourquoi rajouter « et son monde » ne fait rien au mouvement en cours
Je ne veux ni cracher, ni me hausser au dessus de tout ce qui se passe et ne se passe pas au cours de ce mouvement dit « contre la loi travail ». Parfois, les mots servent précisément cette fonction-là. Au final, il est vrai que dire et écrire est une mobilisation très limitée des fonctions corporelles et mentales. Il y en a d’autres qui ont autant d’importance : les bras qui font des gestes, les jambes qui savent courir, et les cœurs qui battent. Les premiers se détachent trop aisément de ces derniers et risquent ainsi de se constituer comme monde à part. Le risque, on le porte chaque fois qu’on ouvre la bouche ou qu’on se met à bouger nos petits doigts pour écrire. Et pourtant…
Quoique je me réjouis avec pas mal d’autres de quelques instants pleinement vécus au cours de ce mouvement, l’enthousiasme de certains me laisse perplexe. J’entends qu’« il y a quand-même des trucs intéressants Place de la République », parce qu’au final, c’est un endroit pour se rencontrer. J’entends qu’on est « de plus en plus nombreux », parce qu’il y a plus de monde qu’avant dans le cortège « autonome » ou « non-affilié », selon le goût de chacun. J’entends que les syndicats « se radicalisent » parce que certains de leur membres se masquent pendant les manifs. J’entends aussi qu’on est « plus combatifs » parce qu’il est devenu indispensable de ramener les lunettes de plongée et un masque aux manifs, grâce à la générosité des flics quand il s’agit du gaz lacrymogène. En plus, davantage de monde déteste la police, parce que cette dernière s’est avérée être vraiment vraiment méchante. Et pour certains, tout se résume par un « ça va péter » hurlé par quelques hooligans qui ont troqués le stade pour le « champ social ».
Je ne conteste aucune de ces observations à la fois descriptives et optimistes. Quant à la description de l’état de fait, je ne donne tort à personne. Par contre, pour les enthousiasmés, je conteste leur enthousiasme.
Parce que, tout comme pour la parole et l’écriture, beaucoup de ce qui est gagné en forme, est aussi perdu en contenu, et il serait une erreur de penser que l’un pourrait remplacer l’autre. Aujourd’hui, par exemple, une grosse partie de la discussion tourne (toujours) autour de la question de la casse. Et je ne parle pas des ennemis tels Le Monde, Libération, RT, Figaro et tous les autres qui sont bien célèbres. Je parle des sources « militantes », souvent dédiées à la justification des pratiques dites radicales. Ça part dans tous les sens : on casse et on s’affronte aux flics, parce que les jeunes, ils en ont marre, ou bien ils sont jeunes, vous ne comprenez pas, ou bien ils n’étaient pas comme ça avant que la police n’ait montré ce dont elle est capable, ou bien ils détestent l’avenir misérable qui leur est promis, ou bien… On cherche des phrases courtes et économiques pour justifier ce que les gens font avec leurs propres motifs, comme si ces derniers étaient rendus clairs seulement par le biais des tactiques elles-mêmes. Des motifs qui ne sont souvent ni brefs, ni forcement économiques. De plus, les motifs sont complexes, parfois évasifs. Comment peut-on expliquer une telle chose, de quelque côté que ce soit, d’une manière si proche de celle des sociologues ? Ces derniers au moins cherchent des correspondances arbitraires qui leurs conviennent statistiquement, alors que pour ceux qui veulent à tout prix justifier une méthode de lutte tout est déjà clair dans la forme.
Mais ces courtes justifications, pourquoi les cherche-t-on ? Pour convaincre que les temps difficiles exigent des mesures proportionnelles à la difficulté ? Ne retombe-t-on pas comme ça sur le même débat fatiguant sur « la violence » et « la non-violence », quoique dans un vocabulaire un peu plus branché et mieux adapté à l’époque ?
Allons, ne nous fatiguons pas. Mais comme on a commencé par la casse, parlons d’elle, mais cette fois, pas pour la justifier. Début avril de cette année, suite à un blocage dans le cadre du mouvement dit contre la loi travail, quelques lycéens de l’affreux lycée Léonard de Vinci à Levallois-Perret mettent le feu aux poubelles. Le feu endommage la cage. Presque deux mois plus tard, 47 lycéens sont convoqués à la Sûreté Territoriale, plusieurs sont placés en garde à vue. Il y a des initiatives de soutien, trouver des avocats, donner des conseils, soutenir les accusés, etc. Tout cela est important, évidemment. Mais pourquoi les lycéens ont-ils fait ça ?
Certains expliquent que les lycéens étaient très très énervés parce que les autorités de l’abrutissement institutionnel ne leur ont pas donné le permis d’aller manifester. Mais en fait, quoique je ne m’interrogerai pas sur les « véritables » motivations des auteurs, espérons inconnues, de ce que des milliards d’enfants partout rêvent de voir arriver, je poserai ceci comme une hypothèse très probable : le fait de mettre le feu à son école a plus à voir avec l’école qu’avec la loi travail. Plus précisément, cela a quelque chose à voir avec une manifestation bien concrète de ce monde autoritaire et marchand, que les enfants et les adolescents subissent quotidiennement. Certains d’entre eux se saisissent des conditions favorables et donnent forme à leur dégoût.
Bien que le mouvement en cours soit souvent présenté non seulement « contre la loi travail », mais aussi contre « son monde », peu d’autres aspects de ce dernier sont invoqués. Allant jusqu’au point où certains protègent une boutique Emmaüs, collabo de la machine à expulser déjà attaqué en tant que tel, de ses assaillants, comme ce fut le cas pendant la manifestation du 26 mai dernier. Mais bien que certains peuvent ignorer ce qu’est Emmaüs, tout le monde sait ce qu’est l’école. C’est une institution qui est possiblement plus essentielle au « monde de la loi travail » que la loi maudite elle-même.
Et pourtant, les solidaires des lycéens défendent ces derniers seulement en tant qu’accusés et non en tant qu’écoliers qui détestent l’école au-delà de toute considération juridique sur leur « culpabilité » ou « innocence ». Certes, le travail technique est important. Mais si c’est dans le cadre du mouvement contre la loi travail et son monde qu’on est solidaires avec les lycéens, comment est-ce possible que cet aspect de son monde, l’école, soit laissé intact au profit de la question des accusés ?
Voilà d’où provient ma langueur. Malgré les tactiques, très belles, parfois moins, et malgré les manifestations de plus en plus masquées, le « et son monde » de ce mouvement me paraît de plus en plus brouillé. Parce qu’en regardant ailleurs -dans les cafés, dans les rues, dans les transports en commun, au travail- avec des exceptions notables, la conversation tourne autour de la casse, les manifs, les nuits de boue, les « violences policières » parfois… Bref, des points techniques, comme s’il n’y avait que ça. Certains sont contre, d’autres pour, la plupart s’en foutent. Très peu semblent toucher l’essentiel et la raison pour laquelle nous sortons de chez nous, seul ou en groupe, le jour ou la nuit, manif ou pas, pour donner un peu de cohérence à notre dégoût de cette société marchande et autoritaire : l’incompatibilité de la vie qui nous est imposée et de celle qu’on veut vivre, celle qui serait digne de son nom.
Peu importe que les gens éprouvent de la sympathie pour les gestes, même les plus « radicaux ». Qu’on soit plus nombreux ou pas dans les cortèges « autonomes », qu’on soit plus masqués que jamais, les actes minoritaires de révolte ne cherchent pas des adeptes. Ils cherchent à contribuer à la tension sociale afin de polariser ce monde d’un côté, et que la vie ne soit pas que de la merde de l’autre. Si on « s’énerve », si on « déborde », si on casse tout simplement, ce n’est pas parce cette loi nous empêchera de réussir dans cette société ; c’est parce que la moindre perspective d’y réussir va à l’encontre de tout ce qui rend la vie digne d’être vécue : la beauté, la passion, le bonheur, la liberté – ne les mesurons pas.
Pourtant, accordons-le, il y a des brèches qui s’ouvrent dans le contexte de ce mouvement. Il y a des moments de rupture. Tout cela existait avant et existera après. Continuons donc de les chercher et continuons d’y contribuer. Mais continuons de telle façon que lorsque ce mouvement mourra -et il va certainement mourir- des brèches ne cessent de s’ouvrir et que la rupture continue de pointer son nez là où personne ne l’attend. Si un jour on arrive à relier tout cela ensemble, peut-être qu’on fera face à une possibilité réelle de subversion de cette invivable société.